Article
Entreprises en difficulté : la procédure de conciliation en 9 points clés
Date de publication : 10.04.25
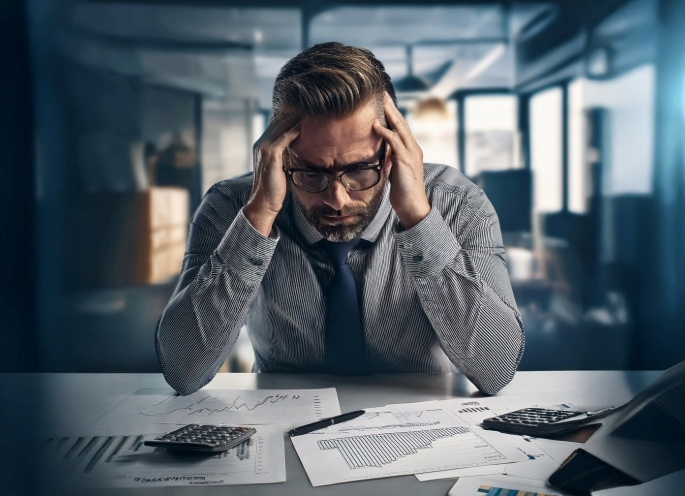
La conciliation est une procédure de prévention qui a pour objectif de favoriser le redressement d’une entreprise en difficultés par le biais de la conclusion d’un accord entre l’entreprise et certains de ses créanciers qui lui consentent notamment des délais de paiement ou des remises de dettes.
En cas d’apparition de difficultés économiques ou structurelles, il est important d’agir le plus tôt possible sur les difficultés rencontrées avant que l’entreprise ne devienne totalement défaillante et que les éventuelles procédures possibles ne soient trop restrictives ou qu’elles desservent l’entreprise concernée par leur aspect non confidentiel.
L’objectif est de convaincre tout dirigeant concerné d’agir rapidement de manière préventive, de l’informer des caractéristiques de la procédure de conciliation ainsi que les différentes étapes de la procédure.
1 – Pourquoi recourir à la conciliation ?
Les difficultés rencontrées par une entreprise peuvent être de différentes natures : économiques, financières, juridiques, sociales.
Lorsque ces difficultés sont juridiques ou sociales, il existe des modes de conciliation ou de règlement de conflits prévus soient par le Code de commerce soit par les statuts de la société elle-même. Bien sûr, voici une reformulation plus fluide et claire de ton texte :
Lorsque les difficultés rencontrées sont d’ordre économique ou financier, il arrive que des accords ponctuels soient négociés directement entre l’entreprise et ses créanciers. Cependant, ces démarches sont souvent tardives, et l’on a alors recours à des solutions juridiques plus radicales, telles que le redressement ou la liquidation judiciaire, une fois l’état de cessation des paiements avéré.
Mais il peut être souvent plus judicieux d’anticiper cet état de cessation des paiements pour se placer sous la protection du tribunal dans le cadre d’une procédure de conciliation qui va permettre de trouver une solution à des difficultés financières sans attendre l’état de cessation des paiements.
Les difficultés financière rencontrée peuvent être de plusieurs ordres/
- Des tensions de trésorerie
Une entreprise peut se retrouver dans l’incapacité de couvrir ses dépenses courantes avec les liquidités disponibles, ce qui engendre des tensions sur sa trésorerie. - Un accès limité au financement
Il peut également arriver que l’entreprise peine à mobiliser les ressources nécessaires pour investir et soutenir son développement, faute de solutions de financement adaptées. - Un manque de rentabilité
Lorsqu’il devient difficile de générer un bénéfice, la structure souffre alors d’un déséquilibre économique affectant sa rentabilité. - Un niveau d’endettement trop élevé
Malgré une activité en cours, l’entreprise peut ne plus être en mesure d’honorer ses engagements financiers à long terme, du fait d’un endettement trop important.
L’origine de cette situation financière dégradée peut être due à de nombreux facteurs, qui malheureusement peuvent se cumuler. Parmi lesquels :
- Une mauvaise gestion du budget accompagnée de dépenses de matériel imprévues
- Une baisse de chiffre d’affaires due à la perte d’un ou de plusieurs clients
- Une baisse de chiffre d’affaires due à une baisse de la demande dans un contexte économique inflationniste
- Une augmentation importante des charges fixes et variables liée aux coûts de production, au personnel …
- Une pression concurrentielle renforcée par les prix bas des entreprises étrangères, conséquence de la mondialisation
- L’émergence d’une crise économique entraînant une forte baisse du pouvoir d’achat et, par conséquent, une diminution de la consommation
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle illustre les causes qui entrainent l’apparition de difficultés chez les entreprises et sans pour autant que soit en cause nécessairement la gestion du chef d’entreprise. Face à des événements extérieurs ou à des aléas propres à la vie de l’entreprise, la survenue de difficultés financières impose bien souvent une réaction rapide. Il est en effet essentiel d’agir sans tarder afin d’éviter de basculer dans un état de cessation des paiements, ou de s’y maintenir trop longtemps — une situation qui, statistiquement, peut s’avérer fatale.
Les entreprises, les structures concernées par ces difficultés vont perdre en crédibilité non seulement auprès des fournisseurs, mais aussi des banques et de leurs différents partenaires. Ces entreprises n’auront aucune capacité de rebondir en se développant, car le développement nécessite des ressources. Et à terme, le risque principal sera la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Il est nécessaire lorsque cette situation est constatée, et au vu des enjeux, d’agir immédiatement.
Agir vite, c’est se donner la chance de rebondir
avant qu’il ne soit trop tard !
2 – Quelles conditions doivent être réunies pour garantir le succès d’une conciliation ?
L’article L611- 4 du Code de commerce prévoit que la conciliation peut être ouverte par toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et à toute société commerciale éprouvant des difficultés juridiques, économiques, ou financières, avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en cessation de paiements depuis plus de 45 jours.
La procédure de conciliation est possible dans deux situations :
- Lorsque l’entreprise ne se trouve pas en état de cessation de paiements
- Lorsque l’entreprise se trouve en cessation des paiements depuis moins de 45 jours
A contrario du mandat ad hoc, cette procédure est moins restrictive et offre la possibilité aux entreprises éligible de demander l’ouverture de la procédure. A cet égard, elle permet une certaine flexibilité qui permet de se placer sous protection du tribunal et d’échanger avec les créanciers de l’entreprise dans une temporalité plus souple. Dès lors que l’état de cessation de paiements n’est pas constaté, se posera alors nécessairement la question de l’arbitrage entre le recours au mandat ad hoc ou la conciliation.
En pratique, le recours à l’une ou l’autre des procédures va dépendre de la nature des créanciers et des négociations à mener. Les avantages propres à la conciliation incitent fréquemment à engager d’abord une procédure de mandat ad hoc, puis à solliciter la constatation de l’accord obtenu dans ce cadre sous la forme d’une conciliation — une démarche souvent encouragée par les établissements financiers, pour des raisons qui seront développées ultérieurement.
3 – Comment initier une procédure de conciliation ?
Seul le chef d’entreprise ou le représentant légal de la Société est en mesure de demander l’ouverture d’une telle procédure. Pour cela, il est nécessaire de soumettre une demande au Président du Tribunal de Commerce compétent.
Cette requête doit être motivée et préciser la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, ainsi que les besoins financiers, les éventuelles mesures de redressement envisagées et la date de cessation des paiements.
Des pièces sont nécessaires et doivent être fournies à l’appui de la demande du chef d’entreprise, notamment :
- Un extrait KBIS
- Un état des créances et des dettes avec échéancier et la liste des principaux créanciers
- Un état actif et passif des suretés et des engagements hors bilan
- Une situation de trésorerie actuelle et prévisionnelle
- Un compte d’exploitation prévisionnel
- Les comptes annuels
Le chef d’entreprise est ensuite convoqué pour un entretien par le Président du Tribunal de commerce. Tout comme dans le cadre du mandat ad hoc, cet entretien va permettre d’étudier la situation, de déclencher l’ouverture de la procédure, de désigner le conciliateur, de fixer l’étendue et les contours de sa mission, sa durée d’intervention ainsi que sa rémunération. Tous ces éléments seront fixés par l’ordonnance prise par le Président du Tribunal de commerce.
4 – Quel est le rôle du chef d’entreprise aux côtés du conciliateur ?
Lors de la procédure, le chef d’entreprise conserve la direction de son entreprise, il n’est pas démis de ses fonctions et conserve la maîtrise des échanges avec le conciliateur.
Le dirigeant aura pour mission d’informer, de constater, de discuter et de trouver des solutions avec le conciliateur et les créanciers, tout en continuant à gérer son entreprise.
De plus, il peut suggérer au tribunal le conciliateur de son choix. Bien que la décision finale appartienne au tribunal, celui-ci a tendance à accepter le conciliateur proposé. Il est donc souvent judicieux de préparer à l’avance la mission du conciliateur avec le candidat envisagé, en définissant à la fois le périmètre de la conciliation et ses modalités financières. Cette préparation préalable avant la désignation par le tribunal est souvent un facteur clé de succès et assure une meilleure coordination des parties impliquées durant la procédure.
Comme pour le mandat ad hoc, le conciliateur désigné peut être soit la personne proposée par le chef d’entreprise au Président du Tribunal, soit une personne choisie directement par le Président du Tribunal de commerce.
Le Président du tribunal sélectionne alors le conciliateur parmi les mandataires ou administrateurs judiciaires, des professionnels spécialisés dans les entreprises en difficulté.
Le rôle du conciliateur est de prendre connaissance de la situation, de proposer des solutions éventuelles et de lancer les négociations et discussions avec les créanciers afin d’assainir la situation de l’entreprise et de maintenir son activité à long terme grâce à la conclusion d’un accord amiable. Le conciliateur doit également rendre compte de l’avancement de sa mission au Président du Tribunal de commerce.
5 – Quel est le rôle des créanciers dans la procédure de conciliation ?
Tous les créanciers de l’entreprise concernée sont invités à négocier. Cependant, ils ne sont pas obligés de participer ni de parvenir à un accord.
Les créanciers seront là pour défendre leurs intérêts mais aussi trouver des mesures et consentir des délais de paiement ou des remises de dettes à l’entreprise afin que celle-ci puisse sortir la tête de l’eau et maintenir son activité.
Néanmoins, selon l’issue de la procédure et l’avenir de l’entreprise, ils peuvent avoir un réel intérêt à être partie prenante aux discussions et à l’accord.
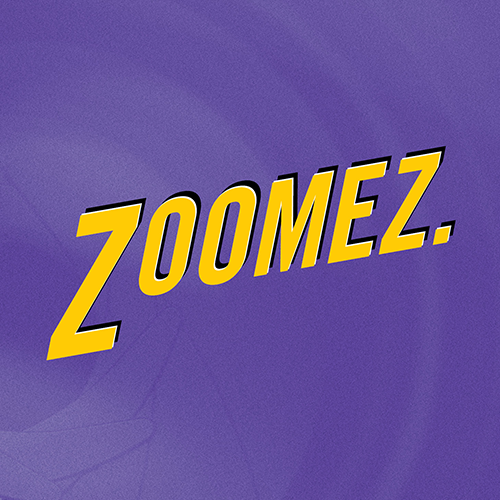
En cas d’homologation de l’accord, les créanciers ayant consenti à l’entreprise concernée un nouvel apport de trésorerie ou la fourniture d’un nouveau bien ou service pour assurer la poursuite de son activité, bénéficieront à ce titre d’un privilège de paiement en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective. C’est ce qu’on appelle le « privilège de new money » ou privilège « d’argent frais ». Cela confère aux créanciers une priorité de paiement, c’est-à-dire qu’ils seront réglés à hauteur de leur apport AVANT les autres créanciers.
6 – Quels sont les avantages de la confidentialité pendant la phase de négociation ?
La procédure de conciliation revêt un caractère important : il s’agit d’une procédure confidentielle.
Toute personne intervenant dans la procédure et/ou qui a connaissance de l’ouverture d’une procédure de conciliation se doit de respecter la confidentialité et de ne rien révéler à quiconque. Cette procédure peut à terme perdre son caractère confidentiel, mais ce ne sera qu’à l’issue de la procédure. En effet, cette caractéristique permet d’éviter de provoquer des inquiétudes et des préoccupations chez les salariés ou certains partenaires de l’entreprise, et de compromettre les négociations en cours. Dans certains cas, l’atteinte à la réputation d’une structure peut causer des dégâts du fait de la connaissance de l’existence de difficultés.
La procédure de conciliation n’est en aucun cas obligatoire et ne peut être initiée que par la décision du chef d’entreprise. Personne ne peut le contraindre ou le forcer à demander l’ouverture d’une telle procédure.
Par nature, la conciliation est une procédure préventive, c’est-à-dire qu’elle a pour objectif d’agir en prévention et en amont pour gérer les difficultés existantes, prévenir les difficultés à venir et ainsi éviter que l’entreprise ne se trouve en cessation de paiements depuis plus de 45 jours.
Cette procédure repose sur la volonté du débiteur, c’est-à-dire le chef d’entreprise, et de certains de ses créanciers de trouver ensemble des compromis pour maintenir l’activité et rétablir une situation financière plus saine et durable. Aucun des deux interlocuteurs ne sera contraint par le conciliateur à accepter des décisions contraires à son intérêt.
La procédure de conciliation dure en principe quatre mois; elle peut être prolongée d’un mois à la demande du conciliateur faite auprès du Président du Tribunal de commerce.
Il est important de noter que les poursuites individuelles engagées contre l’entreprise par les créanciers ne sont pas suspendues (contrairement au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire). Dans ce contexte, avec le droit de poursuite des créanciers, si l’entreprise est en état de cessation des paiements, il peut être pertinent de comparer l’option de la conciliation avec celle du redressement judiciaire. Ce dernier mettrait fin aux poursuites individuelles, mais présente l’inconvénient de ne pas garantir la confidentialité.
Il est possible pour le chef d’entreprise de demander un étalement sur deux ans aux créanciers dont les créances sont antérieures à la procédure sauf en ce qui concerne les dettes fiscales et sociales.
7 – Quelles sont les différentes étapes de cette procédure ?
En collaboration avec le conciliateur, le chef d’entreprise doit faire des propositions aux créanciers afin d’échelonner, d’étaler ses dettes et maintenir les emplois et l’activité de son entreprise. Cela supposera bien évidemment d’établir un prévisionnel d’activité et de justifier les hypothèses retenues au plus près de la réalité de l’activité de l’entreprise.
A cet égard, il est extrêmement important que les différents intervenants travaillent de concert (chef d’entreprise, expert-comptable, avocat, conciliateur). L’objectif du conciliateur est de permettre au débiteur et à certains créanciers de trouver un accord, en octroyant des remises, des délais de paiement ou en restructurant les crédits de l’entreprise. Ces mesures offriront un répit à l’entreprise, lui permettant de maintenir son activité tout en remboursant progressivement ses dettes.
Etant donné que cette procédure repose principalement sur du volontariat et sur de la négociation de gré à gré, certes sous l’égide du conciliateur, il est possible que celle-ci soit un échec notamment en raison d’un rejet de la part du chef d’entreprise des propositions du conciliateur ou encore à défaut d’accord entre lui et ses créanciers. Le conciliateur constatera alors l’échec de la procédure et demandera au Tribunal de mettre un terme à sa mission. Si l’entreprise est en cessation de paiements, le chef d’entreprise, le ministère public ou l’un des créanciers pourra bien évidemment demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Heureusement, la procédure de conciliation peut réussir et permettre à l’entreprise de maintenir son activité, ce qui est avant tout dans son intérêt.
8 – L’accord de conciliation ou comment sortir par le haut de la procédure ?
Dans ce cas, sur requête conjointe du chef d’entreprise et de ses créanciers, le Président du Tribunal rendra une ordonnance donnant force exécutoire à l’accord de conciliation établi entre les différents intervenants de la procédure.
L’accord peut revêtir des effets et conséquences différents selon qu’il est constaté ou homologué.
- L’accord constaté
Le président vérifie la forme de l’accord et statue sur la base de la déclaration du chef d’entreprise. Ce dernier doit attester qu’il n’était pas en cessation des paiements à l’ouverture de la procédure ou que celle-ci a mis fin à cet état. Le tribunal donne force exécutoire à l’accord en le constatant simplement. Cette forme d’accord est particulièrement avantageuse pour le chef d’entreprise, car elle garantit la confidentialité totale de la procédure et de ses conséquences.
- L’accord homologué
Il est possible de demander l’homologation de l’accord, à condition qu’il permette à l’entreprise de maintenir durablement son activité et qu’il ne lèse pas les créanciers non-signataires. Dans ce cas, le tribunal auditionne les parties à l’accord, les représentants du personnel, le conciliateur et le ministère public. L’homologation prend effet dès le prononcé du jugement.
Attention ! Cette forme d’accord entraîne la perte de la confidentialité de la procédure en raison des mesures de publicité.
Néanmoins, contrairement à un accord constaté, l’accord homologué ne peut pas être annulé au motif que l’entreprise se trouvait en cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord. Par ailleurs, comme indiqué, plus haut, l’homologation offre aux créanciers signataires la possibilité de bénéficier du privilège de new money en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective. L’homologation permet également la levée des interdits bancaires pour l’entreprise.
9 – Que se passe-t-il une fois l’accord conclu ?
La conclusion d’un accord est une étape fondamentale dans la procédure de conciliation mais elle n’en est pas le terme. Pour que cette procédure soit un véritable succès, il est nécessaire que l’accord soit appliqué et respecté dans la durée. En effet, la non-exécution de l’accord peut avoir des conséquences bien plus graves que l’absence d’accord. Si la procédure est mal gérée ou non suivie d’effet, elle n’évitera malheureusement pas le risque de redressement judiciaire, voire de liquidation judiciaire.
L’accord ne concerne généralement pas toutes les créances ni tous les créanciers.
Il convient de distinguer deux cas :
- la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur pour les créances faisant l’objet de l’accord
- Pour les autres créances, le débiteur peut encore être poursuivi par les créanciers.
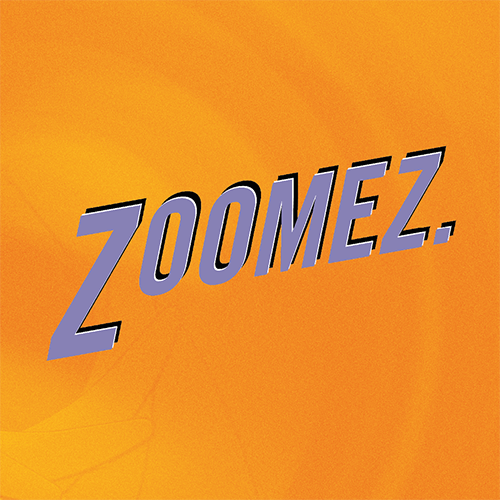
Les garants bénéficient d’une certaine protection grâce à l’accord conclu, car les créanciers ne peuvent pas les poursuivre pour les créances couvertes par cet accord.
Cependant, si des poursuites individuelles sont engagées contre le débiteur pour d’autres créances, celui-ci peut demander des délais de grâce au Président du tribunal.
Attention, ces délais ne s’appliquent pas aux garants, qui peuvent donc être poursuivis à leur tour
L’accord conclu ne signifie pas systématiquement réussite et sauvetage de l’entreprise mais il y contribue fortement si la procédure est bien maîtrisée et qu’un accord raisonnable est trouvé dans l’intérêt à la fois de l’entreprise et des créanciers. Cet accord, son contenu, sa validité peuvent être remis en cause dans trois situations :
- Absence d’exécution de l’accord et saisine du tribunal par les parties en vue de demander la résolution de l’accord
L’accord disparaîtra de manière rétroactive, comme s’il n’avait jamais existé. Il est possible que le tribunal décide de revenir sur les délais de grâce accordés pendant la procédure.
- Exécution de l’accord
Les parties ont respecté l’accord, il a été exécuté en totalité, il devient alors caduc.
- L’ouverture d’une procédure judiciaire contre l’entreprise met un terme à l’accord de plein droit.
À propos de L'auteur

Emilie Picaud
Juriste
Emilie Picaud intervient en droit des sociétés et droit des affaires au sein des agences de l’Aigle et de Mortagne. Elle accompagne principalement les dirigeants de la région Normandie.





Vous avez aimé cet article, vous avez une question ? Laissez un commentaire